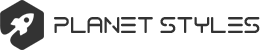[Cinéma] Le Topic Général
Re: Cinoche
OMG ! Mais c'est quoi ce film ??? 


- Bran Noircorbac
- Sorcier
- Messages : 2690
- Enregistré le : 21 janv. 2005, 22:29
- Localisation : Elsass
- Contact :
Re: Cinoche
seulement à nanar mag!^^Cymoril a écrit :Rhaaaa, je ne peux pas être d'accord avec toi. Je me suis prise des claques monstres au cinoche qui auraient été bien moindres devant une télé. Je trouve que l'ambiance d'une salle de cinéma (le noir, le silence, le fait d'être immergé dans le film et projeté dans l'écran) est assez magique dans son genre (bon ok, pas si on va voir des navets). Et s'il faut payer pour ça (du moment que ça reste raisonnable) pourquoi pas ? Faut envisager ça comme un spectacle, un moment unique.
Bon si j'ai compris, tu veux devenir critique dans une revue de cinéma, c'est bien ça ?
Rhaaaa, je ne peux pas être d'accord avec toi. Je me suis prise des claques monstres au cinoche qui auraient été bien moindres devant une télé
d'un autre côté, je ne regarde pas non plus les films à la tv. ni la tv tout court. quoique en ce moment, je mate une ou deux séries, mais ça relève de l'exploit.
Bha, un jour peut être...
Votre talent [lecture de textes vains] vient d'augmenter d'un point
- Bran Noircorbac
- Sorcier
- Messages : 2690
- Enregistré le : 21 janv. 2005, 22:29
- Localisation : Elsass
- Contact :
Re: Cinoche
Znorkh a écrit :Ouais. Mais en septembre, y'a Machete.
wah. quand même.
Votre talent [lecture de textes vains] vient d'augmenter d'un point
-
Znorkh
- Porte Etendard
- Messages : 792
- Enregistré le : 21 nov. 2004, 14:49
- Lecture du moment : Résurgences (Ayerdhal)
- Localisation : Lyon
Re: Cinoche
Cymoril a écrit :OMG ! Mais c'est quoi ce film ???

Oh, juste mon second geekasme de l'année (après Kick-Ass le bien nommé).
No Future? Future is NOW!
LES MEDIAS MENTENT
lecture en cours:
Résurgences (Ayerdhal)
LES MEDIAS MENTENT
lecture en cours:
Résurgences (Ayerdhal)
-
Znorkh
- Porte Etendard
- Messages : 792
- Enregistré le : 21 nov. 2004, 14:49
- Lecture du moment : Résurgences (Ayerdhal)
- Localisation : Lyon
Re: Cinoche
Bah c'est un peu le second rôle fétiche de Rodriguez. Il joue dans quasi tout ses films (sauf dans Sin City, je crois).
No Future? Future is NOW!
LES MEDIAS MENTENT
lecture en cours:
Résurgences (Ayerdhal)
LES MEDIAS MENTENT
lecture en cours:
Résurgences (Ayerdhal)
- Supernounours
- Annaliste
- Messages : 3834
- Enregistré le : 14 avr. 2004, 10:12
- Lecture du moment : Saga Harry Potter
- Localisation : Bretagne
Re: Cinoche
Et un rôle dans le dernier Predator aussi (produit par Rodriguez), m'enfin il meurt en premier !
- Supernounours
- Annaliste
- Messages : 3834
- Enregistré le : 14 avr. 2004, 10:12
- Lecture du moment : Saga Harry Potter
- Localisation : Bretagne
Re: Cinoche
Alors, aucun retour d'Inception ?!
Je suis sûr que la moitié d'entre vous y est allé...
Un très grand film à mon sens.
Je suis sûr que la moitié d'entre vous y est allé...
Un très grand film à mon sens.
Re: Cinoche
District 9 de Neil Blomkamp
Un immense vaisseau Alien apparaît au dessus de Johanesburg. A l'intérieur 1 million d'extra-terrestre apeurés et désorientés, qui ne savent plus faire fonctionner leur vaisseau.
On les parque "généreusement" dans le District 9. Un ghetto sordide.
C'est le début d'un nouvel apartheid pour ceux qui vont se faire appeller les "crevettes". Les locaux ne peuvent plus supporter la vue des ETet les accusent de tous les maux (insécurité, chômage...)
Wikus Van der Werde est un employé de la MNU, une gigantesque mutinationale paramilitaire. Pas très brillant, un brin gaffeur, il va être chargé de délocaliser le Ghetto à 200 km de là. Dans un premier temps, il est chargé de faire signer les avis d'expulsion. C'est là qu'il va se faire contaminer par un objet alien et son ADN va fusionner avec celui des ET. Il va alors devenir l'homme le plus recherché du monde, car le seul à pouvoir utiliser l'armement alien qui fonctionne avec une reconnaissance d'ADN. La MNU veut le disséquer pour analyser ses organes, il va alors devoir s'échapper dans le seul endroit qui voudra bien l'accpeter: le District 9.
Un excellent film. Des décors magnifiques. Le Ghetto est vraiment abominable, on s'y croirait. Des scènes d'action vraiment sympa. Et puis surtout une réflexion sur le racisme et la peur de l'autre. Je trouve très ironique le choix de l'Afrique du Sud, pays qui a créé puis vaincu l'apartheid.
http://www.district9.fr/
Un immense vaisseau Alien apparaît au dessus de Johanesburg. A l'intérieur 1 million d'extra-terrestre apeurés et désorientés, qui ne savent plus faire fonctionner leur vaisseau.
On les parque "généreusement" dans le District 9. Un ghetto sordide.
C'est le début d'un nouvel apartheid pour ceux qui vont se faire appeller les "crevettes". Les locaux ne peuvent plus supporter la vue des ETet les accusent de tous les maux (insécurité, chômage...)
Wikus Van der Werde est un employé de la MNU, une gigantesque mutinationale paramilitaire. Pas très brillant, un brin gaffeur, il va être chargé de délocaliser le Ghetto à 200 km de là. Dans un premier temps, il est chargé de faire signer les avis d'expulsion. C'est là qu'il va se faire contaminer par un objet alien et son ADN va fusionner avec celui des ET. Il va alors devenir l'homme le plus recherché du monde, car le seul à pouvoir utiliser l'armement alien qui fonctionne avec une reconnaissance d'ADN. La MNU veut le disséquer pour analyser ses organes, il va alors devoir s'échapper dans le seul endroit qui voudra bien l'accpeter: le District 9.
Un excellent film. Des décors magnifiques. Le Ghetto est vraiment abominable, on s'y croirait. Des scènes d'action vraiment sympa. Et puis surtout une réflexion sur le racisme et la peur de l'autre. Je trouve très ironique le choix de l'Afrique du Sud, pays qui a créé puis vaincu l'apartheid.
http://www.district9.fr/
- Supernounours
- Annaliste
- Messages : 3834
- Enregistré le : 14 avr. 2004, 10:12
- Lecture du moment : Saga Harry Potter
- Localisation : Bretagne
Re: Cinoche
Un premier film impressionnant pour le poulain de Peter Jackson. Il est d'ailleurs pressenti pour réaliser The Hobbit.
J'ai bien aimé District 9 moi aussi, notamment le cadre et les bestioles, vraiment originaux. Mais le film a pour moi un grand défaut : son insupportable héros. Du coup aucune identification de ma part, j'avais juste envie de le voir mourir.
SPOILER : Sa pseudo rédemption finale m'a semblé totalement improbable...
Vraiment dommage car, pour le reste, ça déchire !
J'ai bien aimé District 9 moi aussi, notamment le cadre et les bestioles, vraiment originaux. Mais le film a pour moi un grand défaut : son insupportable héros. Du coup aucune identification de ma part, j'avais juste envie de le voir mourir.
SPOILER : Sa pseudo rédemption finale m'a semblé totalement improbable...
Vraiment dommage car, pour le reste, ça déchire !
Re: Cinoche
a voir en vo car dans la vo certain passage sont neteemnt plus sensibles concernant l afrique du sud
les plus extremistes des "racistes" sont en effet des afrikaners,parler en afrikaner dans le film
les plus extremistes des "racistes" sont en effet des afrikaners,parler en afrikaner dans le film
faire court c est mieux
le synthetisme plus qu une idée un mode de vie
le synthetisme plus qu une idée un mode de vie
Re: Cinoche
Frankenstein Junior de Mel Brooks
Attention film culte!
Bon tout le monde connait l'histoire donc je ne m'étendrai pas dessus. Par contre certains gags sont vraiment poilants. En plus c'est bien joué, les acteurs n'en font pas trop, celà ne vire donc pas à la grosse farce burlesque.
J'ai beaucoup aimé le bossu interprété par Marty Feldman.
Quelques photos ici
Je recommande ce film à tous ceux qui veulent se marrer un bon coup.
Attention film culte!
Bon tout le monde connait l'histoire donc je ne m'étendrai pas dessus. Par contre certains gags sont vraiment poilants. En plus c'est bien joué, les acteurs n'en font pas trop, celà ne vire donc pas à la grosse farce burlesque.
J'ai beaucoup aimé le bossu interprété par Marty Feldman.
Quelques photos ici
Je recommande ce film à tous ceux qui veulent se marrer un bon coup.
Re: Cinoche
Exact ! ^^ Alors je ne me lancerai pas dans une critique qui spoilerait obligatoirement mais j'ai adoré. La réalisation et les acteurs sont bons mais le scénario est à couper le souffle. Déjà que de ce point de vue The Dark Knight m'avait pas mal enthousiasmée, là j'ai eu envie de remercier Nolan de ne pas prendre les spectateurs pour des idiots.Supernounours a écrit :Alors, aucun retour d'Inception ?!
Je suis sûr que la moitié d'entre vous y est allé...
Un très grand film à mon sens.
- Supernounours
- Annaliste
- Messages : 3834
- Enregistré le : 14 avr. 2004, 10:12
- Lecture du moment : Saga Harry Potter
- Localisation : Bretagne
Re: Cinoche
Un blockbuster intelligent comme on dit.
Et ça fait du bien.
Sinon j'ai bien aimé la trilogie Millénium. J'avais raté les bouquins alors ça m'a fait une petite session de rattrapage.
Les films suédois sont tellement rares dans notre contrée et Noomi Rapace est assez extraordinaire...
Et ça fait du bien.
Sinon j'ai bien aimé la trilogie Millénium. J'avais raté les bouquins alors ça m'a fait une petite session de rattrapage.
Les films suédois sont tellement rares dans notre contrée et Noomi Rapace est assez extraordinaire...
Re: Cinoche
tam-tam a écrit :Frankenstein Junior de Mel Brooks
Attention film culte!
Bon tout le monde connait l'histoire donc je ne m'étendrai pas dessus. Par contre certains gags sont vraiment poilants. En plus c'est bien joué, les acteurs n'en font pas trop, celà ne vire donc pas à la grosse farce burlesque.
J'ai beaucoup aimé le bossu interprété par Marty Feldman.
Quelques photos ici
Je recommande ce film à tous ceux qui veulent se marrer un bon coup.
Tu me rappelle un vieux souvenir, la...
J'ai vu ce film à sa sortie - vers 1975
J'ai tellement rigolé que... ma très chère dent en porcelaine sur pivot (justement l'incisive sup bien devant) a sauté quelque part dans le cinoche bondé....
Et cherche-cherche-cherche à 4 pattes entre et sous les sièges - super! je l'ai retrouvée non écrasée
lectures en cours : Par delà la lue bleue de simon Green
vision : le Prisonnier
vision : le Prisonnier
Re: Cinoche
Grâce à toi, il y avait de l'ambiance à la fois sur l'écran et dans la salle!
Re: Cinoche
Vu Bubba Ho Tep sur arte cette nuit
Me suis bien marrée :
Film ZZZZ -mais je n'ai pas ronflé
Pas de quoi "culter" comme "the big Lebovski" mais j'opte quand même pour le "très sympa"
Pour le pitch d'abord : "Kennedy in black" et "Elvis the pubis" à l'hospice bien glauque, chez les "red-necks"
Très bons acteurs ( mais un peu faible sur la réalisation )
Je ne gloserai pas sur l'obtention d'un "supplément d'âme"
ni sur les "tags" de Bubba Oh tep, la momie-zombie"
Me suis bien marrée :
Film ZZZZ -mais je n'ai pas ronflé
Pas de quoi "culter" comme "the big Lebovski" mais j'opte quand même pour le "très sympa"
Pour le pitch d'abord : "Kennedy in black" et "Elvis the pubis" à l'hospice bien glauque, chez les "red-necks"
Très bons acteurs ( mais un peu faible sur la réalisation )
Je ne gloserai pas sur l'obtention d'un "supplément d'âme"
ni sur les "tags" de Bubba Oh tep, la momie-zombie"
lectures en cours : Par delà la lue bleue de simon Green
vision : le Prisonnier
vision : le Prisonnier
Re: Cinoche
Bubba oh Tep ne vous a pas convaincu??? 
Passons donc aux choses sérieuses : attention : grrrrand classique : STALKER d'Andrei Tarkovski 1979
attention : grrrrand classique : STALKER d'Andrei Tarkovski 1979
Magnifique - évidence : Tarkovski transcende le visuel et ses acteurs sont époustouflants
ouf que j'ai lu le livre avant ! je ne jurerai pas que je n'aurais pioncé ferme, autrement Rolling Eyes
Sinon, rien à voir avec ma lecture du roman -
Tout est "métaphysique" dans le film - pas le moindre artéfact ou la moindre allusion à une antenne d' ET ou de fourmi -
Tarkovski reprend la fin pour en faire le but des expéditions dans la zone -
il exacerbe la quête "spirituelle" en ôtant toute dimension SF
Pour moi, ce n'est pas un film SF du tout -
Je me suis demandé comment les Strougatski ont pris ça :
avec courtoisie, humilité et rès intelligemment
(voir l'article de libé ci- dessous (copié-collé obligé, car le lien est mort )
Sinon, les premiers plans sépias de la chambre du Stalker m'ont irrésistiblement fait penser à ceux de "la ligne générale" d'Eisenstein
- dont l'autre titre est "l'ancien et le nouveau" - et forcément, j'y vois une bonne dose "d'anticommunisme primaire" -
Marfa -> Stalker ! on est revenu au point de départ - la servitude, la misère et le pourrissement
-seule, la zone est liberté et vérité même - surtout par ses rêves et mirages ( ils passent leur temps à y pioncer plutôt inconfortable)
c'est pourquoi elle est interdite, la zone
Cela restera un film marquant pour moi - exceptionnel par le résultat :
à partir de la lecture d'une oeuvre, ce qu'en fait un cinéaste de génie, avec une interprétation diamétralement opposée à ma propre lecture- chapeau!
Passons donc aux choses sérieuses :
Magnifique - évidence : Tarkovski transcende le visuel et ses acteurs sont époustouflants
ouf que j'ai lu le livre avant ! je ne jurerai pas que je n'aurais pioncé ferme, autrement Rolling Eyes
Sinon, rien à voir avec ma lecture du roman -
Tout est "métaphysique" dans le film - pas le moindre artéfact ou la moindre allusion à une antenne d' ET ou de fourmi -
Tarkovski reprend la fin pour en faire le but des expéditions dans la zone -
il exacerbe la quête "spirituelle" en ôtant toute dimension SF
Pour moi, ce n'est pas un film SF du tout -
Je me suis demandé comment les Strougatski ont pris ça :
avec courtoisie, humilité et rès intelligemment
(voir l'article de libé ci- dessous (copié-collé obligé, car le lien est mort )
Sinon, les premiers plans sépias de la chambre du Stalker m'ont irrésistiblement fait penser à ceux de "la ligne générale" d'Eisenstein
- dont l'autre titre est "l'ancien et le nouveau" - et forcément, j'y vois une bonne dose "d'anticommunisme primaire" -
Marfa -> Stalker ! on est revenu au point de départ - la servitude, la misère et le pourrissement
-seule, la zone est liberté et vérité même - surtout par ses rêves et mirages ( ils passent leur temps à y pioncer plutôt inconfortable)
c'est pourquoi elle est interdite, la zone
Cela restera un film marquant pour moi - exceptionnel par le résultat :
à partir de la lecture d'une oeuvre, ce qu'en fait un cinéaste de génie, avec une interprétation diamétralement opposée à ma propre lecture- chapeau!
Boris Strougatski raconte la genèse du mythe
Par FRÉDÉRIQUE ROUSSEL
Arkadi et Boris Strougatski Stalker Traduit du russe par Svetlana Delmotte. Edition définitive établie par Viktoriya Lajoye. Denoël «Lunes d’encre», 222 pp., 22 €. L'Ile habitée Traduit du russe par Jacqueline Lahana. Même éditeur, 432 pp., 24 €.
C’est en 1972 que les inséparables frères Arkadi et Boris Strougatski publient Stalker, pique-nique au bord du chemin. En 1979, Andreï Tarkovski l’adapte librement à l’écran. La Zone est cette étendue figée, lugubre et mortelle qui attire les Stalkers comme des chercheurs d’or. Dans ces années-là et jusqu’à la Glasnot, les Strougatski ne trouvent plus d’éditeurs et sont contraints de publier sous le manteau. Si Arkadi, son frère aîné avec qui il a écrit la plupart de ses textes, est mort en 1991, Boris vit toujours à Saint-Pétersbourg. Célèbre dans son pays, il anime depuis des années un séminaire annuel de formation des écrivains de science-fiction, il est membre du jury de plusieurs prix littéraires et suit de près les parutions en imaginaire. Interview avec l’auteur du roman culte.
______________D’où est née l’idée de Stalker et de la Zone, à la fois dangereuse et attirante ?
L’histoire est née d’un rien, d’une observation tout à fait aléatoire. En nous promenant dans un bois, nous sommes tombés sur une clairière régulièrement souillée par les amateurs de pique-nique en forêt : papiers gras froissés, bouteilles vides, une chaussure oubliée sous un buisson, quelqu’un avait jeté les piles de sa lampe de poche, les boîtes de conserve traînaient dans les restes d’un feu de camp et il restait une flaque d’huile là où une personne avait vidangé son moteur. Et l’un d’entre nous s’est demandé : «Comment les petits êtres qui peuplent ce bois - les oiseaux, les scarabées, les fourmis, un renard apeuré mais curieux - ont-ils pu interpréter cette dévastation ?» Le sujet s’est instantanément imposé. Le soir même, nous avions inventé la Visite, la Zone, les chasseurs de miracles au sein de cette Zone (qu’à l’époque nous appelions «trappeurs»). Le récit, je m’en souviens, a été facile à écrire, sans blocage.
Pourquoi Tarkovski a-t-il choisi de l’adapter ?
Je ne sais pas. A mon avis, il était plus préoccupé par l’image de la Zone, qui est d’ailleurs la seule chose qui soit restée dans le film. Il était très difficile de travailler avec lui, mais c’était diablement amusant. Nous avions décidé dès le début que le destin nous avait conduits à travailler avec un génie et que nous devions nous plier à tous ses caprices, sauf s’ils entraient en contradiction avec notre vision du monde. Le plus dur a été de le convaincre que la fiction n’avait pas à être «fabuleuse», qu’il fallait dépeindre le monde de façon aussi réaliste que possible, et que le fantastique devait se cacher quelque part à la limite de la perception, à la périphérie du sujet : le bois, l’herbe, la station électrique abandonnée. Tout est absolument ordinaire, mais on peut ressentir sur sa peau la sensation froide du miracle qui peut surgir au-delà du tournant… Bien sûr, Tarkovski savait tout cela autant que nous, mais il préférait un «imaginaire franc», de vraies terreurs ou des périodes de temps figé. Peut-être avait-il aussi d’autres raisons essentielles. Il était réalisateur : il pensait non par mots, comme nous, mais à l’aide d’images sonores, qu’on ne peut décrire par aucun mot. Nous lui avons écrit huit scénarios différents, mais il restait insatisfait. Il avait déjà tourné le film lorsque - heureusement ? - la pellicule fut abîmée lors du développement, et il prit la décision de tout refaire. Et en premier lieu, il nous a demandé de modifier l’image du Stalker. Il ne souhaitait plus avoir à faire à ce demi-bandit, ce vagabond féroce de la Zone. Il voulait quelque chose d’autre. «Et quoi donc, sapristi ?- Je ne sais pas, bon sang ! Mais tout autre.» Alors, avec Arkadi, nous avons, de désespoir, inventé le stalker-fanatique, le stalker-innocent, le stalker-sacré. Il s’est trouvé que c’était cela qu’il voulait ! Quand vous travaillez auprès d’un génie, vous devenez un peu génial.
Comment jugez-vous cette adaptation ?
Arkadi, je me souviens, le considérait comme un «film du XXIe siècle». Je suis plus réservé, mais suis sûr d’une chose : c’est un film merveilleux.
Stalker et l’Ile habitée parlent-ils encore aujourd’hui ?
Ils ont été liés à une certaine réalité, et ils le sont toujours, dans la mesure où cette réalité n’a pas changé. Ou du moins, lentement. Et Maxime Kamerer [le personnage principal de l’Ile habitée, ndlr] lutte maintenant contre le totalitarisme de la même manière que dans les années 70. Et les Stalkers modernes sont encore impuissants à comprendre ce qu’est le bonheur et comment, et par quelle magie, le procurer à ce monde où le bien se fait sur la base du mal («parce qu’il n’y a plus rien d’autre pour le faire») (1).
Pourquoi avez-vous décidé d’écrire de la science-fiction ?
Pour une raison très simple : nous aimions beaucoup lire de l’imaginaire. Mais il s’en publiait tristement peu au milieu des années 50. Sans compter que la moitié des auteurs travaillaient alors dans un genre encouragé, celui de l’«imaginaire à court terme» (dans lequel les vrais héros sont des inventions technologiques de demain : le tracteur automatique ou les chaussures inusables). Mais nous savions comment, dans les faits, on pouvait écrire de l’imaginaire ! Nous connaissions Alexeï Tolstoï, Alexandre Beliaev, H. G. Wells, Jules Verne et nous voulions écrire ainsi. Il nous semblait que nous pourrions y arriver, non pas pour être publiés, mais pour lire plus tard notre petit chef-d’œuvre à des amis, aussi fans du fantastique que nous-mêmes. Nous avons essayé. Et nous avons réussi.
Comment vous répartissiez-vous la tâche avec votre frère ?
Nous écrivions toujours à deux. En général, c’était Arkadi qui s’installait à la machine, et moi je déambulais dans la pièce ou je restais allongé sur le divan d’à côté. L’un d’entre nous proposait une phrase, l’autre y réfléchissait, proposait une autre rédaction. S’ensuivait une discussion, parfois courte, parfois d’une demi-heure. Finalement, la phrase «s’arrangeait» et était couchée sur le papier. L’un de nous proposait la phrase suivante, etc. C’est ainsi que phrase après phrase, paragraphe après paragraphe, page après page, le texte prenait forme. Nous créions ce texte à deux, à parts égales, c’était la fusion de deux représentations. Ça n’était pas un sandwich ni une pâte feuilletée, mais bien un alliage.
Séparer ce qui est d’Arkadi et ce qui est de moi est impossible. Bien sûr, lorsqu’il était question de seppuku, de samouraïs et d’autres choses japonaises, on devine que la primauté dans la discussion revenait à Arkadi, en tant que japonisant. Ou bien lorsqu’il s’agissait d’armes, de casernes, de l’armée en général, c’était encore Arkadi, qui fut officier de carrière. Par contre, lorsqu’il était question de planètes, d’étoiles, de galaxies, de cosmologie, c’était mon tour, en raison de mon diplôme en astronomie stellaire. Les mathématiques, la cybernétique, les ordinateurs étaient aussi de mon domaine. Et aussi la poésie japonaise, dont j’étais, à la différence d’Arkadi, un grand amateur et connaisseur. Par contre, les domaines de la physique et de la technique étaient de nouveau du ressort d’Arkadi, qui avait là, sans doute, la priorité du fait qu’il s’intéressait depuis son plus jeune âge à la physique nucléaire et avait lu à ce sujet une bibliothèque entière d’ouvrages de vulgarisation… Voilà. Maintenant, essayez de résoudre le problème de la répartition des tâches…
La littérature doit-elle prendre position ?
Ça dépend. Si nous parlons de devoir, tout écrivain qui se respecte doit tout abord «brûler par la Parole les cœurs des humains» (2). Ce faisant, peut-on ne pas «prendre position» ? Peut-être. Il faut prendre position concernant sa conception de monde. Mais cela n’est pas la même chose qu’une position politique. A l’époque soviétique, on nous persuadait que rien ni personne n’existait hors de la politique, que l’apolitisme, en effet, est aussi une politique, qu’il était impossible de se tirer de l’autodétermination politique («Si tu n’es pas avec nous, tu es contre nous»).
A mon avis, toutes ces formules idéologiques magiques n’avaient qu’un seul sens pratique : séparer le bon grain de l’ivraie - ceux qui ont accepté «la communion du Buffle» (3) de ceux qui ne l’ont pas acceptée et donc se sont automatiquement transformés en objet à surveiller, et en cas de nécessité, en objet de répression. Dans un socium du type démocratique, la question de l’appartenance politique ne se pose pas. Elle n’a simplement aucune raison d’être.
Traduit du russe par Viktoriya et Patrice Lajoye
(1) Citation extraite des Fous du roi de Robert Penn Warren, déjà utilisée dans Stalker.
(2) Pouchkine, le Prophète (note des traducteurs).
(3) Allusion au roman de Heinrich Böll les Deux Sacrements (ndt).
___
lectures en cours : Par delà la lue bleue de simon Green
vision : le Prisonnier
vision : le Prisonnier
Re: Cinoche
OUi j'y suis allé. Film très bien avec effectivement un scénario de folie. Ne rentre sans doute pas dans mon top 10 mais vraiment un excellent moment.Supernounours a écrit :Alors, aucun retour d'Inception ?!
Je suis sûr que la moitié d'entre vous y est allé...
Un très grand film à mon sens.
J'ai vu SALT aussi. Film d'action où on ne s'ennuie pas mais ce n'est pas un chez d'oeuvre, une bonne distraction mais c'est déjà beaucoup.
Lectures actuelles :
Re: Cinoche
Inception, bof !
Film sans intérêt. Scénario cousu de fil blanc. Dès le début du film on sait comment va être la fin.
Film sans intérêt. Scénario cousu de fil blanc. Dès le début du film on sait comment va être la fin.
Lecture en cours : Dived Edding, Ceux qui brillent.
Re: Cinoche
Ah mais c'est comme pour la majorité des histoires, ce n'est pas la fin qui est intéressante, c'est comment on y parvient. ^^
- Gregor
- Sorcier
- Messages : 6436
- Enregistré le : 09 févr. 2004, 14:20
- Lecture du moment : Hypérion
- Localisation : Seine et Marne
- Contact :
Re: Cinoche
j'ai maté valhalla rising hier soir j'ai failli me pendre
dommage la réalisation et l'environnement sont super mais bon le contemplatif ok j'aime ça mais pendant 90% du film faut pas pousser
dommage la réalisation et l'environnement sont super mais bon le contemplatif ok j'aime ça mais pendant 90% du film faut pas pousser
Ma bibliothèque : viewtopic.php?f=9&t=4351
Re: Cinoche
loooool ^^
Je compatis, Gregor. C'est clair que c'est un film un peu perché. Moi, je m'attendais à un film de Vikings bourrins et du coup j'étais un peu déroutée (c'est un euphémisme).
Je compatis, Gregor. C'est clair que c'est un film un peu perché. Moi, je m'attendais à un film de Vikings bourrins et du coup j'étais un peu déroutée (c'est un euphémisme).
Re: Cinoche
Cymoril a écrit :loooool ^^
Je compatis, Gregor. C'est clair que c'est un film un peu perché. Moi, je m'attendais à un film de Vikings bourrins et du coup j'étais un peu déroutée (c'est un euphémisme).
Mais le point de vue des zonorés membres du forum m'intéresse beaucoup plus
(pas le même éclairage)
lectures en cours : Par delà la lue bleue de simon Green
vision : le Prisonnier
vision : le Prisonnier
Re: Cinoche
Bah, comme l'a dit Gregor, c'est contemplatif, onirique, etc. Ce qui n'empêche pas le film de faire surgir de manière sporadique une violence très crue. En gros, c'est une variation expérimentale et métaphysique sur le thème (je sais plus si c'est vraiment un spoiler ça, Greg), du voyage, de la folie, etc. C'est intéressant à voir, bien réalisé, joué, les images sont belles, etc. Mais j'avoue que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais (je voulais voir un film qui bourrinne mais pas comme ça  ). Enfin, si tu as l'occasion, Arsenie, regarde-le, il vaut quand même le coup d'œil.
). Enfin, si tu as l'occasion, Arsenie, regarde-le, il vaut quand même le coup d'œil.
SpoilerAfficher
des Vikings en Amérique